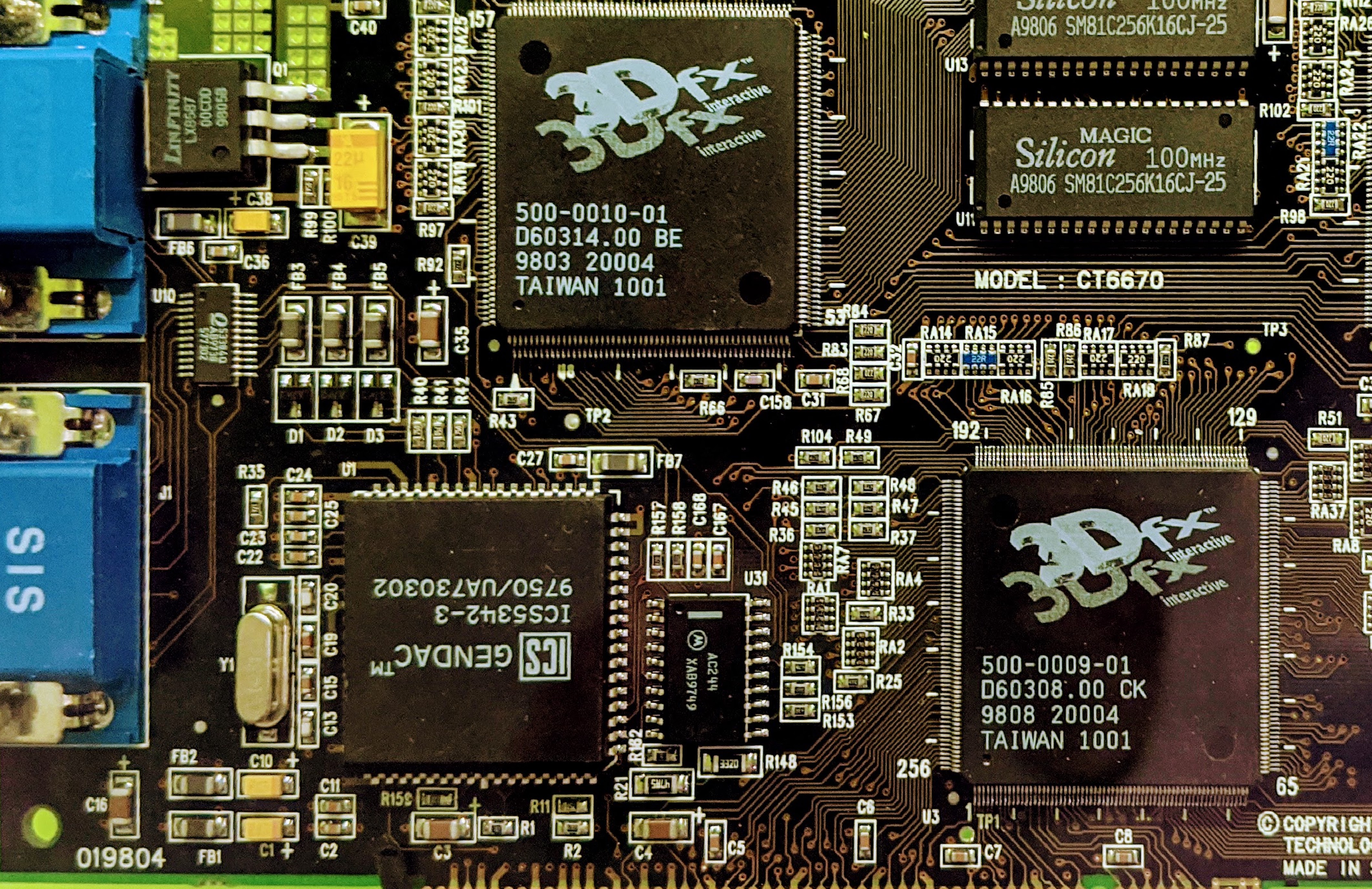Le 21 septembre 2001, l’explosion de l’usine AZF de Toulouse, appartenant à la société Grande Paroisse, une filiale récente du groupe Total, faisant 31 morts et plus de 2500 blessés, fut le plus grand accident industriel depuis la guerre. Compte tenu de l’ampleur des problèmes à régler sur le plan civil avec l’indemnisation des victimes, sur le plan administratif, ainsi que sur le plan judiciaire pénal, trois cabinets d’avocats sont intervenus, réunissant les compétences de leurs 10 associés ou collaborateurs (DSL, leading counsel de la défense, a vu intervenir aux côtés de son équipe, le cabinet Monferran à Toulouse, avec Jacques Monferran et son équipe, et le cabinet Boivin, avec Jean-Pierre Boivin et son équipe).
Le traitement des indemnisations
Avant toute procédure pénale, la première urgence dans cette affaire a été l’indemnisation des victimes pour laquelle il était impensable de faire un traitement judiciaire par voie de référé. Sur l’initiative conjointe de la défense et du Président du Tribunal, une organisation de solution alternative des conflits a été presque immédiatement créée avec très rapidement, un comité de suivi présidé par un magistrat, futur Directeur des affaires civiles, auquel participaient le procureur de la République et les avocats d’associations de victimes. C’est la première fois en France qu’une telle organisation a été mise en place.
Un consensus est très vite apparu dans le processus d’indemnisation. L’objectif était, pour la société, de payer le plus rapidement et le mieux possible. Ceci aboutit à une enveloppe d’environ 2,5 milliards d’euros qui ont été versés d’abord dans les tout premiers mois puis au fur et à mesure des demandes. La société Total avait délégué un de ses directeurs pour régler sur place tous les problèmes qui se posaient. Le cabinet Monferran à Toulouse a joué un rôle majeur dans le succès de ce travail d’indemnisation.
À cette occasion, un nouveau préjudice a été reconnu dans la nomenclature, celui du « préjudice spécifique » né de l’addition de plusieurs dommages constituant par leur ensemble un préjudice distinct et nouveau.
Le traitement pénal de l’affaire
Le traitement pénal a été affecté par plusieurs orientations toxiques.
D’abord, le Procureur de la République a déclaré trois jours après le sinistre qu’à 90 ou 99% il s’agissait d’un accident, ce que rien ne lui permettait d’affirmer. Certes, ce sinistre intervenait dix jours après le 11 septembre et les attentats de New York et des nécessités d’ordre public légitimes ont incité le gouvernement à éviter toute chasse aux sorcières qui aurait pu provoquer des réactions violentes dans certaines cités. Mais ces déclarations du Procureur ont démobilisé la police en l’empêchant de faire immédiatement les actes nécessaires afin de clore, si c’était possible, les recherches sur un attentat :
-
absence de perquisitions dans les délais normaux, retard à l’audition de certaines personnes, auditions de masse des ouvriers, maladresses à l’égard de tout le personnel ;
-
mise en examen au mois de juin de 13 personnes (dont l’une était restée pas même trois semaines dans l’entreprise), et ceci avec un contrôle judiciaire humiliant, pour compenser une faiblesse de charges. 12 d’entre elles ont bénéficié très rapidement d’un non-lieu grâce à la prise en main de l’affaire par un nouveau juge d’instruction.
-
Décision de confier l’enquête au SRPJ de Toulouse plutôt qu’à la gendarmerie et ses services techniques spécialisés.
-
Emprise des déclarations du Procureur de la République sur les experts judiciaires. Leur première hypothèse de confusion des produits avec un dépôt de 500 kg de DCCNa (chlore) sur des tonnes de nitrate a été réduite à néant lors de la reconstitution organisée dès octobre par le juge d’instruction.
-
Présentation par les experts de la cause de l’accident devant les parties civiles regroupées dans une immense salle du palais de justice de Toulouse, au moyen de l’explosion d’un tube de verre contenant en principe du DCCNa et du nitrate. Au bout d’un an et demi, à la défense démontrant qu’il n’y avait ni DCCNa ni nitrate dans le fameux tube, l’expert a avancé comme excuse qu’il fallait faire une expérience avec des produits qui explosent rapidement pour ne pas lasser l’auditoire.
De multiples problèmes juridiques et techniques se posent dans cette affaire mais aussi des questions de bon sens. L’accusation est fondée exclusivement sur la vingt-quatrième expérience des experts, les précédentes ayant toutes échoué. Sans cette « expérience 24 », aucune condamnation n’était possible. En l’absence de cette expérience 24, la chambre d’instruction de Toulouse avait rendu le 1er décembre 2005 une décision de non-lieu général
Selon cette nouvelle hypothèse, deux jours avant le sinistre un ouvrier balayant le sol du hangar de stockage dit 335, aurait ramassé sans s’en apercevoir 1,5 kilo de DCCNa. Il aurait jeté les poussières sur une benne contenant des centaines de kilos de nitrate sortis d’un sac éventré. 48 heures après, déversé sa benne dans le box du hangar 335 sur un sol mouillé de nitrate. Ce faisant, le DCCNa se trouvant sur le dessus de la benne aurait glissé en premier pour se répandre et fermenter au contact du nitrate mouillé. 14 secondes après, le nitrate sec contenu dans la benne serait venu se superposer, constituant comme un sandwich : nitrate mouillé, DCCNa, nitrate sec, et finissant par exploser.
Pour autant, aucune trace de chlore n’avait été découvert par les investigations sur le sol du hangar où il avait été censé être balayé. Pas de chlore, ni en aval, ni en amont.
Décision du Tribunal correctionnel de Toulouse
Cette absence de preuve a amené le Tribunal à prononcer une relaxe générale de grande paroisse et de son directeur. Le 19 novembre 2009. Le Tribunal résumait les principes dans son jugement : « Le droit pénal est un droit qui s’applique strictement et ceci est un des piliers de notre société démocratique ».
Parmi les innovations de la défense, on notera la place accordée par les juridictions à l’expertise technique des prévenus qui, en application de la jurisprudence de la CEDH, ont obtenu certains droits comparables aux experts judiciaires, à savoir la possibilité de rester dans la salle d’audience pour les entendre et pouvoir discuter de leurs arguments oraux.
La défense n’a jamais voulu soutenir une thèse ou une autre, notamment celle de l’attentat compte tenu du fait que les preuves étaient absentes, même si cette absence était causée par le caractère complètement lacunaire de l’enquête préliminaire. La défense n’a pas non plus soulevé d’autres hypothèses, considérant que toutes les démonstrations qu’elle a essayé de faire en s’appuyant sur les scientifiques, ne constituaient pas une preuve au sens judiciaire du terme.
L’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse
La Cour d’appel de Toulouse, au terme d’un arrêt très partial, a au contraire condamné la société Grande Paroisse à une amende pénale et le directeur de l’usine à de la prison ferme. Mais la défense ayant découvert qu’un des assesseurs était vice-présidente d’une association de victimes, elle-même liée à aux parties civiles, a saisi le Conseil supérieur de la magistrature d’une plainte contre cette absence d’impartialité objective de la Cour d’appel de Toulouse. Saisi par le cabinet, le CSM a constaté après enquête que la magistrate concernée avait demandé au Premier Président de la Cour d’être remplacée, compte tenu de ce conflit d’intérêts. Le Président de la composition de la Cour a également demandé au Premier Président de remplacer cet assesseur. Ce fut refusé.
L'arrêt de la Cour de Cassation
La Cour de cassation, dans son arrêt du 13 janvier 2015, a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 24 septembre 2012 pour manquement au principe d’impartialité objective et a annulé entièrement ses dispositions. Elle a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris.
L'arrêt de la Cour d’appel de Paris
Le 31 octobre 2017, la Cour d’appel de Paris a condamné Grande Paroisse à une peine d’amende et son directeur à une peine légère avec sursis. La Cour d’appel a retenu que le scénario des experts (“l'expérience 24”) n’était peut-être pas la réalité mais un exemple de ce qui avait pu se produire.
Le second arrêt de la Cour de Cassation
Le 17 décembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme
La défense a saisi la CEDH d’un recours contre la décision rendue par la Cour d’appel de Paris après rejet du pourvoi. Ce recours concerne la méconnaissance du principe de certitude de la cause exigé par la jurisprudence et appliqué strictement par le tribunal dans son jugement de relaxe. La CEDH saisie de cette affaire peut y mettre un terme ou rouvrir le dossier sur le plan national afin de réviser la condamnation.
Le fond du problème, comme le tribunal l’a réaffirmé dans son jugement, est que le droit pénal est d’application stricte et « ceci est un des piliers de notre société démocratique ». Malgré l’ignorance de ce principe par les Cours d’appel de Toulouse et de Paris, cet attendu historique restera.